Internet et les années 2000 : la réponse e-sens
Navigation
Les ruptures de société
2010 : rupture des plagiats et fraudes
des concepteurs de connaissance
Appréhender les mutations du savoir
En dix ans, l’Internet a révolutionné le monde académique.
Tout s’est accéléré. Les questions auxquelles doivent répondre les chercheurs ont évolué respectivement, en trois décennies, de « Que cherchez-vous ? » à « Que publiez-vous ? », puis à « Quand publierez-vous ? », pour devenir aujourd’hui « Combien d’articles publiez-vous ? » et « Combien de fois êtes-vous cités ? » Être cité ce n’est pas être lu. Être cité c’est participer à la logique libérale de la loi d’une offre et d’une demande indexées à l’H Index et à l’Impact Factor.
Une autre dimension de mutation d’internet est sa promotion du phénomène de peopolisation. L’Internet est devenu la vitrine qui permet à chacun d’exposer ses réalisations, de s’exposer. Une majorité de jeunes collègues ont des pages personnelles sur les réseaux sociaux ou des blogs dédiés et contribuent à des portails thématiques. Bientôt arriveront les premiers sites complotistes.
Nous considérons que l’approche pour éviter que le phénomène de fraude et de plagiat ne devienne exponentiel n’est pas une approche « top-down » avec implémentation de règlements, contrôles des plagiats et sanctions et que, à terme, seule une approche « Bottom-up » conviendra.
Grace à notre infolettre (Newsletter) qui atteint très vite plus de 18’000 abonnés, nous sommes en mesure de proposer des cas à nos lecteurs, sous forme d’intrigues policières, pour lesquels nous posons des questions ouvertes.
Comment procédons-nous ?
- Étape 1 : Sélection de cas symptomatiques
Nous vérifions que le problème soulevé par le cas qui nous est soumis par des correspondants touche le cœur de notre métier de chercheurs et/ou de pédagogues et qu’il sera ainsi compris par la collectivité concernée. Il peut s’agir aussi de fraudes commises par des confrères et mises en exergue par des internautes ou de travaux d’étudiants réalisés en vue de l’obtention d’un diplôme reconnu et dont les auteurs sont convaincus de plagiat.
- Étape 2 : Articulation du cas soumis à l’analyse
Le cas structuré comme un objet de recherche est soumis aux lecteurs. Il est articulé autour des grandes problématiques que soulève la question, de manière à vérifier s’il y a un gisement potentiel de connaissances implicites que l’on ignorerait. Chercheurs, mais aussi enseignants des programmes de doctorat y trouvent une sélection de situations significatives qui permettront à tous de débattre et de s’approprier les règles de déontologie de notre profession.
- Étape 3 : Recueil des informations
Une fois le cas proposé via un questionnaire en ligne à l’analyse de la communauté, le recueil des informations, des impressions, des analyses, des solutions éventuelles se fait par la voie la plus simple : le courrier électronique.
L’essentiel ici est d’obtenir le plus de richesse possible au niveau du contenu et de laisser à chacun la plus grande liberté pour décider de la partager ou non. Cette procédure autorise aussi bien la spontanéité que la réflexion, l’interaction simple ainsi que les échanges répétés, le transfert des messages, la liberté des récipiendaires de mener leurs propres enquêtes auprès d’experts, etc.
Et bien entendu : notre boite à courriels est sécurisée !
Le site Responsable
Entre 2004 et 2008, années de découverte de notre champ de recherche et d’action, ce qui avait débuté comme une conversation entre pairs se déployait auprès d’une large audience. Celle-ci a vite atteint 15 000 membres abonnés à notre newsletter. Ils provenaient de 113 établissements différents, de 13 pays et de 17 disciplines.
Le “parler-vrai” reposait d’abord sur le refus du constat fataliste. Ainsi, le 13 avril 2010, nous usons avec détermination d’une parole désormais décomplexée, inspirée d’Austin (1991) :
« Je dis devant vous qu’un “chercheur”, Directeur général adjoint d’une Grande école française et éditeur d’une revue scientifique, a traduit mot à mot le chapitre d’un livre publié par son doctorant chez un éditeur français, puis l’a publié chez McGraw-Hill sous son nom.
Je dis devant vous que l’établissement d’enseignement supérieur où exerce ce collègue indélicat ne peut pas sanctionner des étudiants plagieurs tant qu’il n’a pas réglé ce cas.
Je dis devant vous que tous les représentants de la Conférence des grandes écoles et tous les présidents d’universités sont concernés. Ils doivent maintenant nous rassurer quant à leur volonté de protéger la connaissance, de nous protéger et de protéger nos étudiants. »
Le site Responsable est une boite à outils pour tous ceux qui rencontrent un problème d’intégrité. On y trouve :
- Une banque de cas de transgressions académiques
- Un kit de contrôle des faux diplômes
- Un kit de soutien aux étudiants
- Des conseils de communication aux étudiants
- Des directives internationales aux chercheurs
- Des rapports de l’Académie Suisse des Sciences
- De l’humour partagé
- Une revue de presse
- Des lettres ouvertes de lecteurs
- Etc.
Charte de fonctionnement du site « Responsable »
- Enjeux : Le site collaboratif « Responsable » s’attache à démystifier la fraude et le plagiat réalisés dans le cadre de l’exploitation de l’internet et souvent détectés grâce à internet. Traiter ce phénomène exponentiel comme un mal à combattre sans en comprendre les raisons profondes serait indigne de notre rôle de chercheur. Nous voulons comprendre pourquoi les fautifs agissent ainsi, au risque de subir des sanctions graves. Cependant, nos règlements concernant la qualification de ces manquements ne sont ni assez clairs et précis, ni suffisamment standardisés d’un établissement à un autre et d’un pays à l’autre. Ce site collaboratif s’attache donc aussi à analyser les failles organisationnelles de notre « ordre académique ».
- Anonymat : Il est garanti à tous les participants du Projet « Responsable, Éthique-plagiat » afin de permettre l’exercice de la parrêsia (la liberté de parole) de chacun, mais aussi l’analyse neutre des cas par nos lecteurs. En aucun cas nous ne stigmatisons des acteurs individuels, puisque l’objet même de ce site est de traiter d’un « fait social total » (au sens de Mauss).
- Protocole de recherche : La méthode générique de ce site est celle de la « recherche-action » (voire de la « recherche-intervention » lorsque nous intervenons à titre d’expert à la demande d’institutions ou de centres de recherche) qui permet à une communauté de débattre d’une situation et d’améliorer par consensus progressifs entre tous les acteurs les règles de vie et de travail en bonne intelligence. L’éclairage des faits par la théorie, puis de la théorie par les faits permet d’induire progressivement de nouveaux concepts et de nouvelles pratiques. La base de données que constitue l’ensemble des lettres parues depuis 2004 témoigne de cette dynamique.
- Politique éditoriale : L’auteur de ce site ne porte pas de jugement de valeur sur les explications subjectives individuelles, ni sur les raisons associatives, ni sur les causes organisationnelles qui tendraient à justifier des pratiques déloyales. Notre ontologie de chercheur conçoit la réalité comme n’étant, ni subjective, ni objective : elle adopte celle du « care », de l’attention aux autres, du lien social dans une époque troublée où les repères de l’action individuelle et collective ne sont pas évidents.
- Participants au projet : Ils sont pédagogues, professeurs, enseignants, mais aussi étudiants. Les témoins ou victimes de fraude dans la production d’écrits ou de publications peuvent soumettre à l’analyse collective des cas qui leur tiennent à cœur. Nous vérifions toujours les éléments factuels relatifs à ces cas avant d’en présenter la substance aux lecteurs dans une lettre largement diffusée. Les participants sont aussi les acteurs qui proposent des règlements, des méthodes ou des procédures mis en place dans leurs établissements et/ou pays et qui contribuent ainsi à enrichir la connaissance collective.
La méthodologie d’analyse et de diffusion
Grace à la newsletter qui atteint très vite plus de 18’000 abonnés, nous sommes en mesure de proposer des cas à nos lecteurs et à qui nous posons des questions ouvertes dessus.
Nous analysons ensuite les réponses.
La méthode des cas que nous privilégions ici a pour objectif d’analyser une situation organisationnelle afin de circonscrire la nature d’un problème et de permettre aux analystes de proposer des solutions pragmatiques.
Comment procédons-nous ?
- Étape 5 : Articulation de l’analyse
Notre but est d’abord d’induire la vision commune du concept qui unifie les perspectives individuelles. Le concept central étudié au travers du cas analysé par nos correspondants est articulé autour de dimensions stables, communes à tous, reposant sur des « observables » notifiés sous forme de faits ou de verbatim significatifs.
La mise en cohérence du champ des actions est induite des discours individuels. Elle reflète les contenus des messages reçus et elle est « habitée » exclusivement de citations des répondants (l’annexe 1 fournit la description de la méthodologie utilisée).
- Étape 6 : La dynamique interactionniste
Notre objectif est de contextualiser l’analyse en éclairant les représentations sociales du phénomène par la compréhension des interactions entre acteurs. Il s’agit de mettre en œuvre « un interactionnisme interprétatif », avec une attention particulière aux « épiphanies » racontées. Ces épiphanies sont les moments d’interaction avec les autres qui vont marquer et souvent transformer sa personne. Notre posture est ici émique car comprendre, relier, retrouver les liens de raisonnements, éclairer de l’histoire individuelle et de la perspective de l’environnement, etc., sont nos outils de travail.
- Ensuite…
Nous publions les résultats de nos analyses, puis les diffusons à la communauté de « Responsable ». De nombreux correspondants les diffusent dans leurs réseaux et ainsi, peu à peu, la communauté dans son ensemble prend conscience de ce phénomène social… et parfois agit.
Bien entendu, le cas est anonymisé : les dates et les noms sont totalement fictifs. Ce cas pourrait bien se produire dans n’importe quel pays et à n’importe quelle époque. C’est ce qui en fait son caractère emblématique.
Documents de recherche à télécharger
- Du plagiat à la normalité N° 2006 – janvier
- Profils de plagieurs Rapport d’analyse 1 N° 2011 006
- Profils de plagieurs Rapport d’analyse 2 N° 2011 009
- Profils de plagieurs Rapport d’analyse 3 N° 2011 010
- Résultats du cas « Enquête à la Columbo » N° 2011 003
- Petit manuel à l’usage des dirigeants N° 2012-001
- Les thèses de complaisance N° 2012 005
- La volonté d’agir N° 2014-007
- Nos communautés disciplinaires N° 2015-002
- Épidémiologie universitaire N° 2015-003
Le réseau social
Ce site collaboratif n’existerait pas sans les contributions de toutes les personnes qui, entre 2004 et 2015, nous apportent leur soutien, leurs témoignages et nous font part de leurs analyses. Ensemble nous faisons évoluer la prise de conscience du phénomène :
Jacqueline Aglietta, Frédéric Agnes, Thérèse Albertini, Victor Samuel Albis Gonzalez, Brigitt Albrecht-Rohn, Alain Alcouffe, Boualem Aliouat, Linda Allal, Claude Almansi, Filipe Almeida, Lionel Alvarez, Virginie Amilien, Christophe Ancey, Bernard Andenmatten, Antonio Andreoli, Marc Arabyan, Gilles Arnaud, Pierre Arrighi, Michel Audétat, Marc Augier, Philippe Aurier, Margareta Baddeley, Olivier Badot, Boubacar Baidari, Serge Baile, Souleymane Baldé, Gabriel Ballif, Marc Banik, Jean-Yves Barbier, Virginie de Barnier, Grégory Barrau, Jacques Barrier, Pierre Bartélémy, Isabelle Barth, Boris Bartikowski, Samuel Bates, Michel Bauer, Denis Bayart, Benoît Bazoge, Daniel Beauchêne, Charles Becker, Ariane Beldi, Dominique Belin, Béatrice Bellini, Lazare Benaroyo, Pierre-Jean Benghozi, Jean-Louis Benoît, Marc Benoun, Nicolas Berland, Michel Berry, Ernesto Berti, Mireille Betrancourt, Gilles Bertrand, Florence Besson, Bernard Beugnot, Bénédicte Bévière-Boyer, François Bianco, Marc Bidan, Yvan Biefnot, Francois Blanchard, Patrick-Yves Blanchard, Françoise Bloch, Vincent Bloch, Didier Boden, Yves Bodeur, Jean-Pierre Boisivon, Christophe Boisseau, Dominique Bonet, Noël Bonneuil, Samuel Bottani, Fatima Bouabdelli, Dominique Bouchet, Hamid Bouchikhi, Yasmine Boughzala, Christèle Boulaire, Jean-Jacques Bourdin, Christian Bourion, Julien Bousquet, Denis Bouyssou, Luc Boyer, Pascal Brassier, Lucie Brazeau Lamontagne, Oliviane Brodin, Patrice Brun, Jean-Jacques Buchon, Alain Bultez, Hervé Burdin, Józef Bury, Sandrine Cadenat, Isabelle Cadet, Marcel Calvez, Vincent Calvez, Estelle Cantillon, Pierre Cao, Paola Capone, Jude Caroll, Marie Carpenter, Philippe Carre, Camille Carrier, Catherine Casamatta, Fabrice Cavarretta, Jean-Jack Cegarra, Mohammed Salah Chabou, Claude Chailan, Jean-Lin Chaix, Ridha Chakroun, Claude Champaud, Jean-Louis Chandon, Olivier Chappuis, Anne Chartier, Jean-Hugues Chauchat, Louis Chauvel, Pierre Chenet, Foued Cheriet, Jacques Chevallier, Marie-Francoise Chevallier-Leguyader, Jean-Marie Choffray, Marie-Andrée Chouinard, André Ciavaldini, Philippe Cibois, Florence Clarac, Coralie Claude, Marianne Clerc, Francis Cohen, Patrick Cohendet, Olga Collaone, Martine Collart, Philippe Collombert, Aurélien Colson, Catherine Coquery-Vidrovitch, Céleste Cornu, Jacques Cortès, Pierre Cossette, Louise Côté, Marcel Côté, René Côté, Christelle Cotton, Thomas Coudreau, François Courvoisier, Catherine Cremieu-Petit, Olivier Crevoisier, Charles Croué, Victoria Curzon Price, Massimo Danzi, Eliane Daphy, Etienne Darbellay, Jean-Noël Darde, Julien Darmon, Denis Darpy, Armand Darrain, Albert David, Pierre-Marie David, Dirk De Hen, Mohsen Debabi, Noëlle Deflou-Leca, Cristina Del Biaggio, Gérald Delabre, Stéphanie Delaunay, Hélène Delerue, Jacques Delga, Robert Deliège, Piera Dell’Ambrogio, Daniel Delmas, François Deltour, Diane Demers, Jean-Philippe Denis, Hugues Derycke, Robert Descargues, Benoît Deveaud, Isabelle Dherment, Christian Dianoux, Jacques Digout, Delphine Dion, Christine Dioni, Sabah Djouad, Francoise Dourver, Dominique Drillon, Olivier Droulers, Claude Dubar, Michel Dubois, Pierre Dubois, Pierre-Louis Dubois, Maryse Dubouloy, Georges Henri Ducreux, Pierre-Henri Duée, Jean Dufer, Eric Dufour, Florence Dufour, Didier Duguest, Lionel Dupuy, Thomas Durand, Jean-Yves Duyck, Bernard Eck, Nadine Eck, Claire Edey Gamassou, Maurizio Gribaudi, Boris Eizykman, Rafael Encinas de Munagorri, Pascal Engel, Denise Esteves, Teresa Estrela, Yves Evrard, Florette Eymenier, Juliet Fall, Gilles Falquet, Jean Ferreux, Eric Fimbel, Béatrice Fleury, Jean-Paul Flipo, Denise Flury Poffet, Yves Flückiger, Sylvain Foissey, Sylvain Foissez, Daniel Fondanèche, Laurent Fontowicz, Pierre-Michel Forget, Bernard Forgues, Jean-Jacques Forney, Marc Foucault, Hélène Frankowska, Jean Frayssinhes, Catherine Fricheau, Gérard Friès, Olivier Furrer, Benoît Gailly, Denis Gallet, Paulo Gama, Yves Gambier, Delphine Gassiot Casalas, Hubert Gatignon, François Gaudu, Stéphane Gauvin, Jean Gayon, Christian Genthon, Anselm Gerhard, Denis Gervais, Vincent Gessler, Jean-Luc Giannelloni, Yvonne Giordano, Christian Girault, Mathias Girel, Richard Glauser, Éric Godelier, Thierry Goguel d’Allondans, Anne Gombault, Pierre-Yves Gomez, Sylvain Gouguenheim, Catherine de Gourcuff, Michel Grandjean, Magali Gravier, Françoise Grize, Danièle Grosheny, Pierre Gruson, Isabelle Gudmundsson, Lyvie Guéret-Talon, Gilles J. Guglielmi, Pierre Guibentif, Alice Guilhon du Hellen, Sylvette Guillemard, Christine Guy-Ecabert, Allegre L. Hadida, Ratiba Hadj-Moussa, Stéphane Haefliger, Taïeb Hafsi, Elisabeth Haghebaert, Jacques Hallak, Pierre de la Harpe, Neil Harris, Natacha Hausmann, Francois D’Hauteville, Françoise Havelange, Stéphane Héas, Thomas Henkel, Maud Herbert, Jane Hervé, Christian Heslon, Monique Hinard, Isabelle Hippolyte, Martine Hlady Rispal, Michel Hochmann, Geneviève Hoffmann, Pierre Hoffmeyer, Sylvestre Huet, André Hurst, Danielle Jacquart, Mériem Jaïdane, Jean-Marcel Jammet, Jean-Marie Janson, Denis Jeffrey, André Joyal, François Julien, Michel Kalika, Emmanuel Kamdem, Bengt Kayser, Michael Kelly, Susan Key, Odile Khoury, Ruediger Klein, Jean-Michel Knippel, Anne-Gaëlle Knorst, Helene Kontzler, Maxime Koromyslov, Haïm Korsia, Michel Kostecki, Geneviève Koubi, Dominique Kreziak, Olgierd Kuty, Ines de La Ville, Mohammed Issam Laaroussi, Richard Ladwein, Idriss Lagrini, Maurice Lagueux, Pablo Laguna, Carine Lallemand, Denys Lamontagne, Gabriel Langouet, Denis Lapert, Laurent Lapierre, Gilles Laurent, Françoise Lavocat, Marlène Lavrieux, Gaël Le Boulch, Olivier Le Gall, Stéphane Le Lay, Jean Leca, Benoît Lecat, Aniko Lecoultre, Marie Lefebvre, Jean-Marc Lehu, Patrick Leleu, Anne Lemonde, Alain Lempereur, Fabien Lepoivre, Frédéric Leroy, Humbert Lesca, Gaël Letranchant, Peter Leuprecht, Claudine Leuthold, Françoise Levaillant, René Levy, Georges Lewi, Yves Livian, Michel Lyonnet du Moutier, Catherine Madrid, Alain Maillard, Hervé Maisonneuve, Noël Mallette, François Mangin, Anna-Belle Marand, Marie-France Maranda, Michel Marchesnay, Camille Martin, Claude Martin, Alain Charles Martinet, Silvano Martello, Cindy Masson, Christophe Masutti, Hélène Maurel-Indart, Isabelle Maurer, Didier Maus, Nonna Mayer, Myriem Mazodier, Ababacar Mbengue, Daisy McAdam, Jean-Pierre Méan, Med Oimar Mecherri, Jacques Menetrey, William Menvielle, Pierre Ménard, Jérôme Méric, Dwight Mérunka, Grant Michelson, Karim Mignonac, Patricia Milano, Daniel Moatti, Chantal de Moerloose, Cécile Moiroud, Jerôme Monnet, Bernard Montaclair, Franco Morenzoni, Edgar Morin, Sonia Morin, Philippe Mottaz, El Mouhoub Mouhoud, François Moureau, Hassane Mouri, Michel du Moutier, Hans Muehlbacher, Pierre Muller, Claire Multeau, Dejan Munjin, Nabil Mzoughi, Gerald Naro, Duc K. Nguyen, Tam Nguyen Phuong, Jean-Jacques Nilles, Jean-Pierre Nioche, Jean-Gabriel Offroy, Luís Adriano Oliveira, Norbert Olszak, Ann O’Neema, Enrique Ortega, Jean-Claude Pacitto, Olivier Parize, Johane Patenaude, Paulo Peixoto, Normand Peladeau, Jean-Eric Pelet, Francine Pellaud, Bruno Péquignot, Daniel Peraya, Roland Perez, Jean-Jacques Perrenoud, Marc de Perrot, Yvon Pesqueux, Martine Peters, Paulo Peixoto, Max Peyrard, Daniel Pfenniger, Andréas Pfersmann, Emmanuel Picavet, Gilles Pierroux, Suzanne Pinson, Charles Piot, Constantin Piron, Frank Plastria, Yves Ploudre, Suzanne Pontier, Marian Popescu, Marie-Domitille Porcheron, Enrico Pozzi, Henri Prade, Bernard Pras, Christophe Premat, Thierry Pun, Alain Quemin, Pascale Quester, Didier Raboud, Daniel Racette, Michel Rainelli, Jean-Daniel Rainhorn, Jean-Pierre Raman, Martine Ray-Suillot, Sophie Reboud, Hervé Remaud, Luc Renaut, Françoise Rey, Emmanuelle Reynaud, Benny Rigaux-Bricmont, Gilbert Ritschard, Laurence Riviere Ciavaldini, Ludovic Rocchi, Pierre Romelaer, Bernard Rordorf, Stephane Rothen, Asaël Rouby, Céline Roudet, Bernard Roullet, Jean-François Roulot, Fatima Roumate, Dominique Roux, Elyette Roux, Jean Roy, Salomée Ruel, Françoise Ruzé, Michèle Saboly, Ricardo Saez, Philippe St-Germain, Damien Salles, Anne Santamaria, Pierre-Yves Saunier, Nada Sayarh, Renato Scariati, Ingo Schandeler, Erika Lynn Scheidegger, Tal Schibler, Marc Schiltz, Nicolas Schmitt, Paul Schubert,Patrick Sentis, Ana Maria Seixas, Michel Sérieys, Ridha Mohamed Shabou, Sally Shenton, Brigitte Simonnot, Thierry Sinda, Nils Solari, Claudio Soravia, Jean-Baptiste Soufron, Yves Soulabail, Sébastien Soulez, David Squire, Daniel Stoecklin, Alain Strazzieri, Peter M. Suter, Patrick Tacussel, Robert Tamilla, Franck Tannery, Michel Tarpin, Aurora Castro Teixeira, Daniel Theisens, Jean-Pierre Thépault, Patricia Thiery, Hermano Thiry-Cherques, Julie Tixier, Antony Todorov, Alain de Toledo, Vinther Torkild, Jean-Marie Toulouse, Mathieu Touzeil-Divina, Giusto Traina, Jean-Marie Tremblay, Laurent Trémel, Yves Trolliet, Pierre Trottier, Didier Truchet, Nicolas Turtschi, Bertrand Urien, Odon Vallet, Christian Vandendorpe, François Vatin, Christine Vaufrey, Etienne Verges, Eva Vicente, Bénédicte Vidaillet, Bernadette Villes, Dominique Vinck, Robert Viseur, Elisabeth Volckrick, Jean-Paul Vulliéty, Elisabeth Walliser, Jacques Walter, Bruno Warin, Sarah Weber, Daniel Weiserbs, Alan Williams, Pierre Windal, Martin Wrede, Thierry Yven, Michel Zendali, Said Zergout, Jacques Ziller, Alexandre Zollinger, Monique Zollinger, Nicolas Zufferey.
Contributions
Les ouvrages
Notre principale production de livres, articles, vidéos, newsletter et posts en matière de plagiat et de fraude est portée par l’Association IRAFPA (institut International de Recherche et d’Action sur la Fraude et le Plagiat Académiques).
Les livres
L’IRAFPA est la seule association scientifique interdisciplinaire à but non lucratif qui publie chaque année un ouvrage en français, alternativement en anglais, et une revue scientifique Les Cahiers de l’IRAFPA, accessible en ligne, comme le sont les Actes de son Colloque de Coimbra.
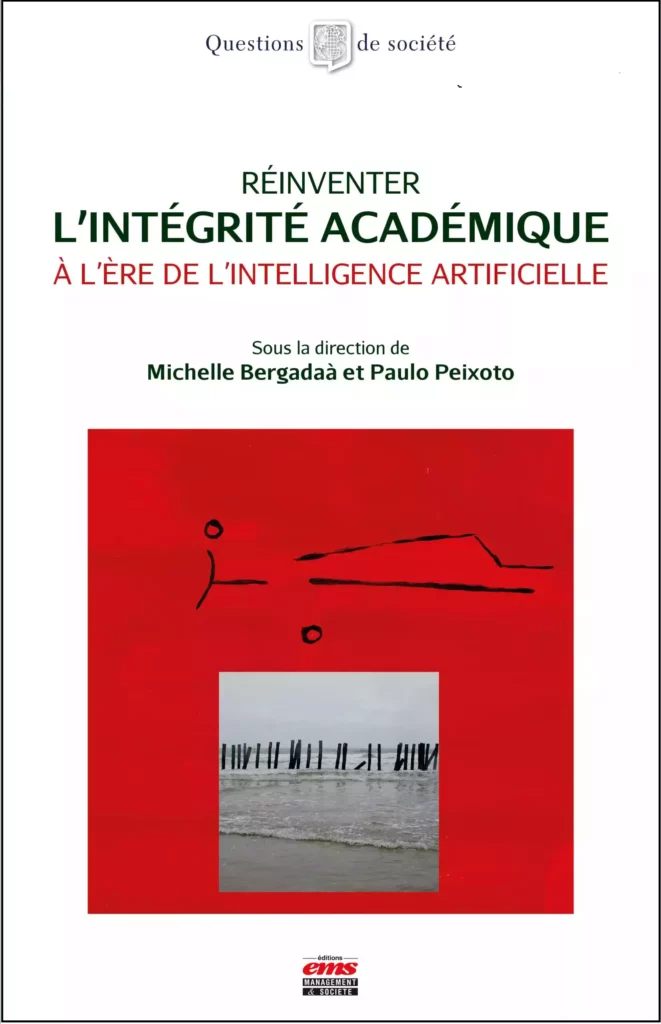
Bergadaà M., Peixoto P. (2025). (Dir.).
Réinventer l’intégrité académique à l’ère de l’intelligence artificielle.
Coll. Questions de société, Éditions EMS Management et Société, Caen, 216 pages.
Nous vivons une période où l’intelligence artificielle redessine ou propose de redessiner les structures mêmes de notre société. Socle premier de la production et diffusion du savoir, le monde académique doit établir des réponses conceptuelles et pragmatiques.
Cet ouvrage multidisciplinaire propose des solutions selon 3 axes : Formation, information et IA / Publications et IA/ Organisations et IA.
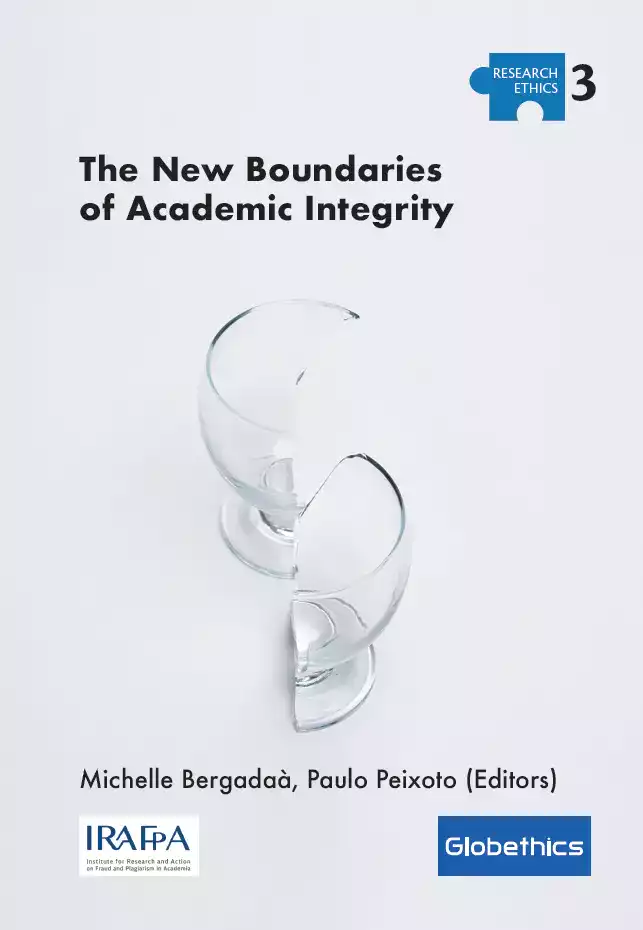
Bergadaà M., Peixoto P. (2024). (Eds.).
The New Boundaries of Academic Integrity.
Research Ethics Series No.3, Globethics, 233 pages. Open Access.
This book extends and completes the construction of the sciences of integrity begun in 2021. Eleven most accomplished contributions of the Coimbra 2022 Colloquium attempt to answer the question of what these new frontiers of integrity are in a changing academic world.
If we were to define a unity of tone between them, it would be that of frankness; a unity of analysis, that of rigor; a unity of vision, that of academic rigor; and a unity of character, that of lucid optimism. The ground assumption of the editors is that multidisciplinarity is central and necessary.
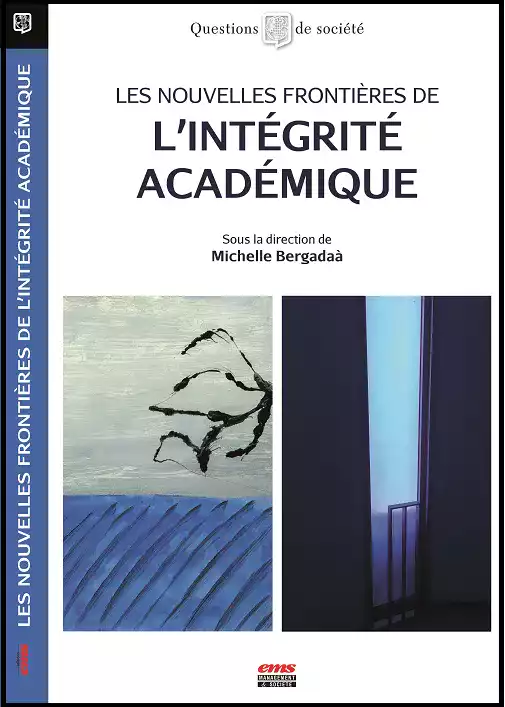
Bergadaà M. (2023). (Dir.).
Les nouvelles frontières de l’intégrité académique.
Coll. Questions de société, Éditions EMS Management et Société, Caen, 216 pages.
Cet ouvrage prolonge et complète la construction des sciences de l’intégrité entamée avec le livre L’urgence de l’intégrité académique paru chez le même éditeur en 2021.
Le mouvement des sciences de l’intégrité, apte à se saisir des niveaux personnel, relationnel et systémique, est bel et bien lancé et que rien ne saurait l’arrêter. La multidisciplinarité est ici le fondement de la validation des propositions intellectuelles.
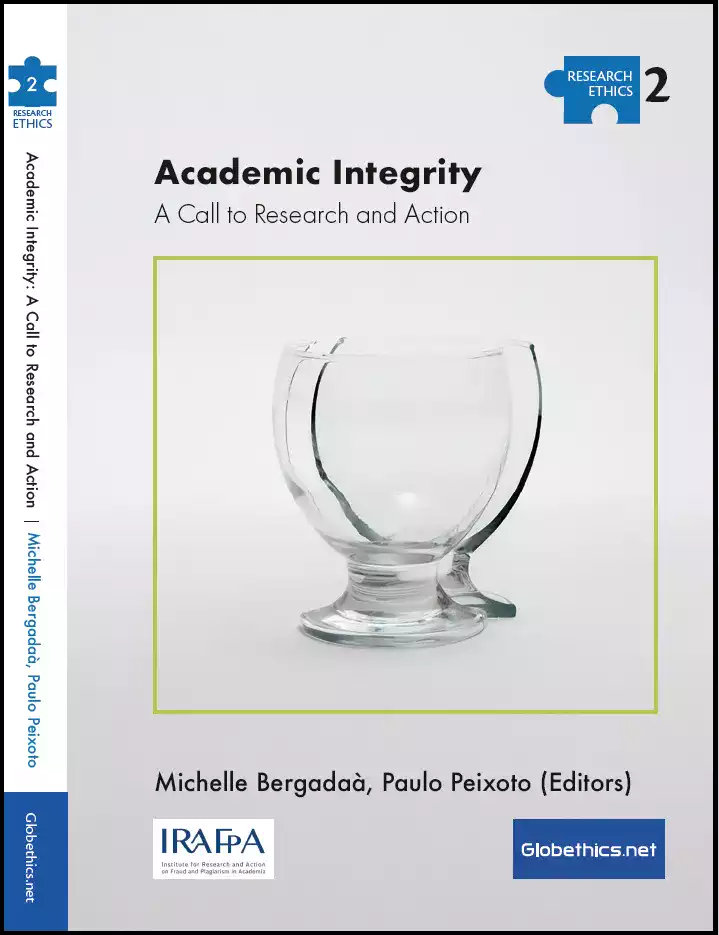
Bergadaà M., Peixoto P. (2023) (Eds.).
Academic Integrity – A Call to Research and Action.
Research Ethics Series No.2, Globethics, 636 pages. Open Access.
Thirty-four contributors from ten different countries explore the ways in which integrity in academic life is shaped and, potentially, damaged.
From the role of publishing to the relationship between the law and the academy, the responsibility of institutions to set cultural expectations, and the part that training can play.
These thoughtful and provocative contributions dig deeply into the problems and suggest possibilities for change of practice of integrity across the spectrum of academic life.
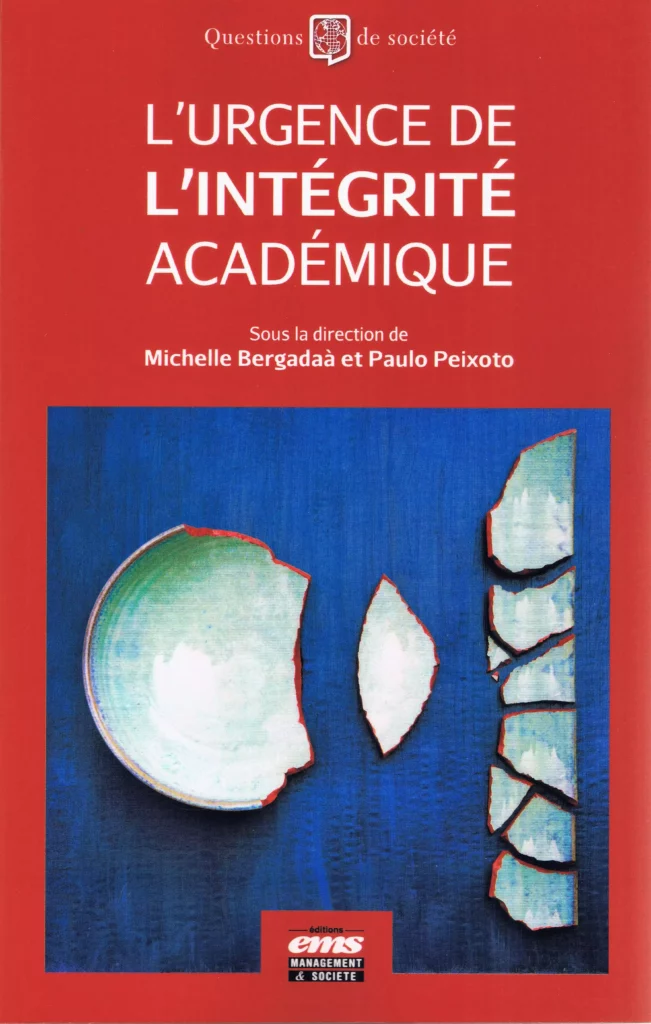
Bergadaà M., Peixoto P. (2021). (Dir.).
L’urgence de l’intégrité académique.
Coll. Questions de société, Éditions EMS Management et Société, Caen, 520 pages.
34 auteurs de 10 pays et de plus de 20 disciplines proposent une construction des sciences de l’intégrité académique.
Labellisé en 2022 par le Collège de Labellisation de la FNEGE, dans la catégorie “Ouvrage de Recherche Collectif”.
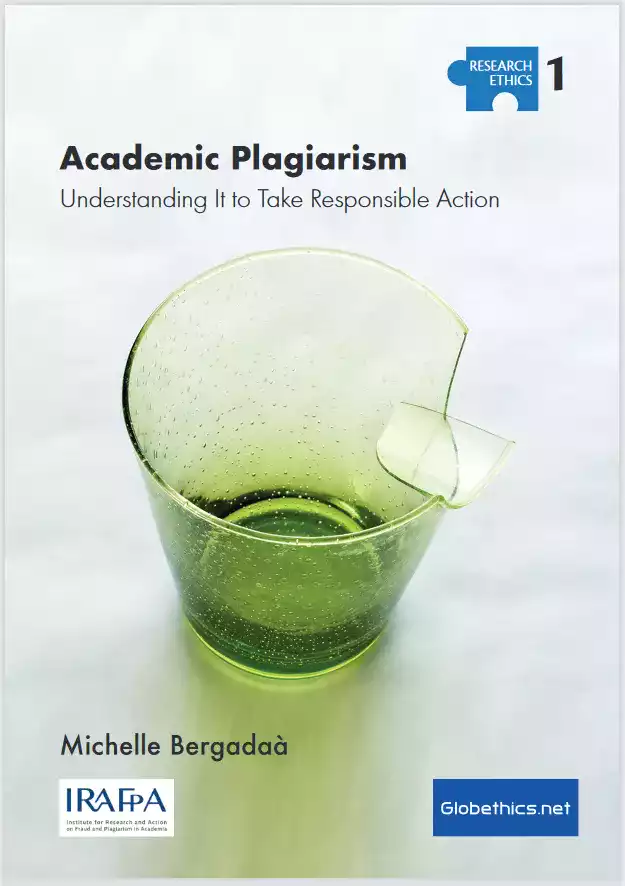
Bergadaà M. (2021).
Academic Plagiarism. Understanding It to Take Responsible Action.
Research Ethics Series No.1, Globethics, 280 pages. Open Access.
Traduction anglaise, augmentée, de notre best-seller, l’ouvrage de 2015 de Michelle Bergadaà sur le plagiat : Le plagiat académique : comprendre pour agir, L’Harmattan, Coll. Questions contemporaines, 228 pages.
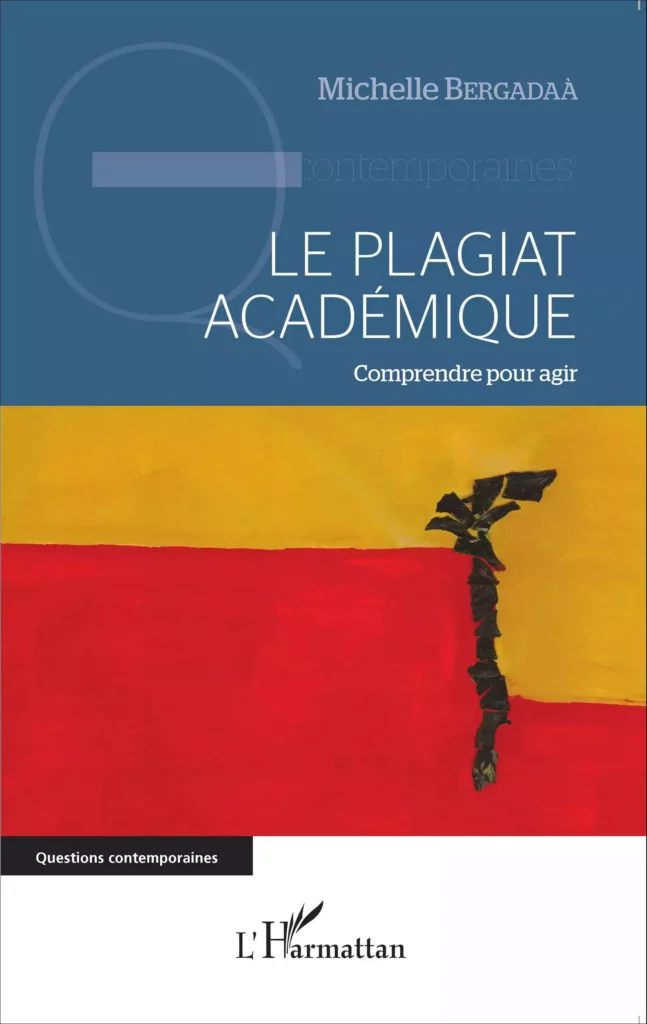
Bergadaà M. (2021).
Le plagiat académique : comprendre pour agir.
L’Harmattan, Coll. Questions contemporaines, 228 pages
La revue « Les cahiers de l’IRAFPA »
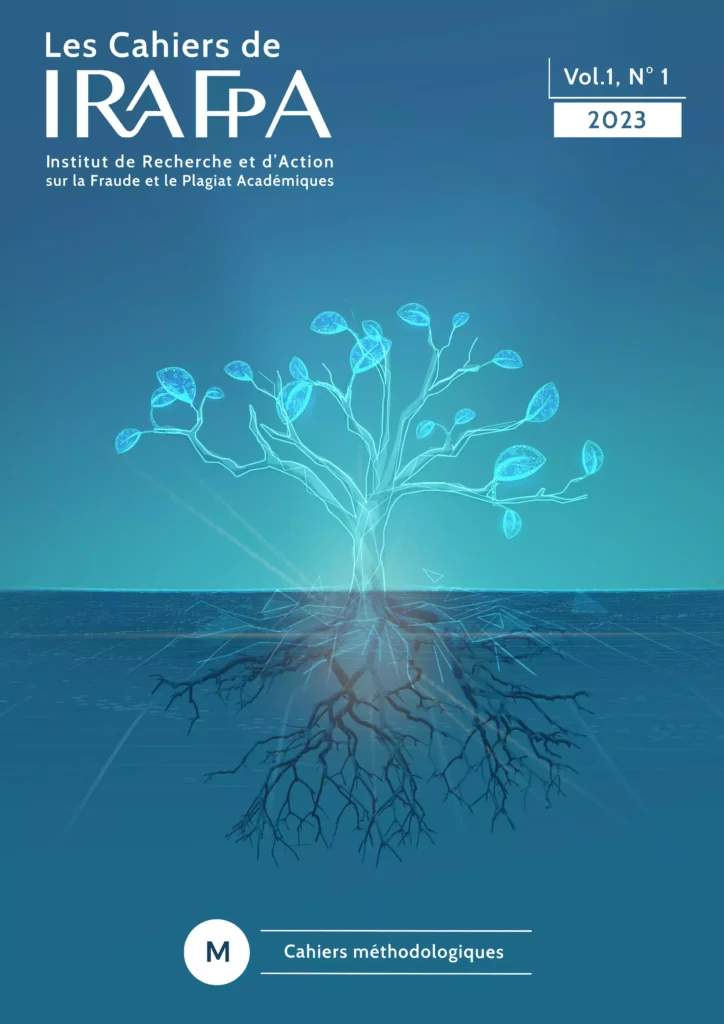
La revue, Les Cahiers de l’IRAFPA est une référence en sciences de l’intégrité.
Les articles sont en français ou en anglais. Les projets d’articles peuvent être issus de débats sur des thèmes d’actualité lors des Écoles d’été, du Colloque de Coimbra ou à l’initiative de tout auteur.
Les Cahiers de l’IRAFPA sont publiés sur la plateforme ouverte du projet suisse www.SOAP2.ch, en Open Access.
Les posts LinkedIn et la Newsletter Responsable
Les actions de l’IRAFPA (publications, conférences, vidéos…) sont publiées chaque quinzaine sur la page LinkedIn de l’IRAFPA (5’000 abonnés).
https://www.linkedin.com/company/irafpa/
Et chaque trimestre via la Newsletter « Intégrité académique » (20’000 souscripteurs).
Le site web irafpa.org
Une abondante documentation est aussi disponible sur le site web de l’IRAFPA
Une vidéothèque y regroupe plus de 75 vidéos courtes de témoignages de spécialistes.
https://fondation-fere.org/lia-des-annees-2025-desinformation-et-mesinformation/#la-videotheque
